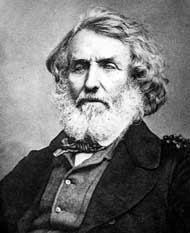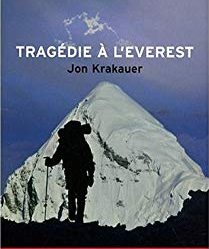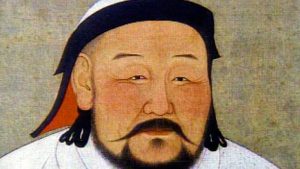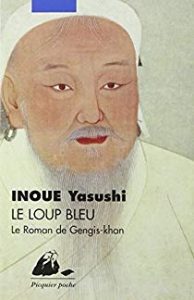Planète Découverte vous emmène au Japon, le pays du Shintoïsme.


Planète Découverte vous emmène au Japon,
le pays du Shintoïsme.
Avant de boucler nos valises pour l’archipel nippon, nous vous proposons – afin de préparer ce voyage adéquatement – de revenir à l’essence même du Japon : le Shintoïsme !
Toujours pratiqué par plus de 70% de la population, il fait partie du quotidien des Japonais depuis des temps immémoriaux. Le Shintoïsme et ses Kamis (divinités ou esprits) rythment leur vie de la naissance à la mort, ils sont présents dans tous les moments de leurs existences qu’ils soient futiles ou capitaux, ils sont invoqués tant pour trouver l’amour que pour réussir des études ou pour faire prospérer des entreprises. Ils réconfortent face aux puissances effrayantes et destructrices de la nature (typhons, tremblements de terre…), ils sont partout dans l’Univers, dans les temples, les maisons, les industries, dans l’esprit des morts et l’Empereur lui-même en est l’incarnation…

Le Shintoïsme ou shinto (神道, shintō, littéralement « la voie des dieux » ou « la voie du divin ») est à la fois une religion et une philosophie de vie qui mélange des éléments polythéistes, chamaniques et animistes.
Il compterait actuellement plus de 100 millions de fidèles repartis presque exclusivement dans l’archipel nippon. Il a su s’adapter, cohabiter et coexister face aux autres courants religieux venus d’ailleurs, comme le confucianisme, le bouddhisme ou encore le taoïsme. À la différence de ceux-ci, le Shintoïsme est une religion autochtone, sa naissance remonte aux origines du peuplement des îles japonaises.

Le Shintoïsme est une religion sans fondateur, ni dogme, ni code moral, ni commandements, ni doctrine. Il est basé sur le respect des Kamis (des esprits) qui sont honorés, beaucoup plus qu’adorés. À proprement parler, ils ne sont pas vénérés, mais il faut s’assurer de leur protection et de leur bienveillance. Il faut en prendre soin et surtout ne pas les froisser, car ils peuvent être à la fois bons et mauvais. Attention, si vous vexez un Kami, il faut alors procéder à des rites de purification pour que l’ordre des choses soit rétabli.

Les Kamis (il en existerait autour de 8 millions) sont des esprits présents dans toutes choses : dans les forces terrestres comme dans les puissances célestes, dans les végétaux comme dans les minéraux. Certains lieux sont ainsi sacrés et considérés comme des Kamis, par exemple certaines cascades ou certains rochers. Le mont Fuji, en plus d’être le symbole de la nation japonaise, est considéré comme un Kami… À travers eux, c’est la puissance et les caprices de la nature que les croyants tentent d’apprivoiser.

Un Kami qui a connu une renommée tristement célèbre est le « Kamikaze » ! Son origine remonte au XIIIe siècle, époque où des hordes de Mongols balayèrent l’Asie et fondèrent un empire qui s’étendait de l’Europe orientale jusqu’en Corée. Après la chute de la Chine impériale, les Mongols commencèrent à regarder plus loin vers l’est, vers le Japon. Les Mongols tentèrent à deux reprises d’envahir l’archipel Nippon, mais à chaque fois un typhon détruisit une grande partie de leur flotte et les envahisseurs en déroute durent regagner le continent. Ils n’attaquèrent jamais plus le Japon. Ce typhon fut appelé kamikaze « le vent divin ou l’esprit du vent » – et devint le symbole de la victoire dans l’esprit des Japonais. Le mot fut repris vers la fin de la Seconde Guerre mondiale par les pilotes japonais qui dirigeaient délibérément leurs avions sur les bateaux ennemis qu’ils frappaient de plein fouet…

Le Shintoïsme, à travers ses traditions, ses coutumes et ses légendes, établit une mythologie qui légitime le pouvoir des empereur japonais.
Selon la légende : Deux divinités, Izanagi et Izanami (qui étaient frère et sœur), créèrent un monde constitué de toutes les divinités de la nature, notamment Amaterasu (déesse du Soleil), Tsukiyoni (dieu de la lune) et Susanoo (dieu de la tempête) … Plus tard, Ninigi, le petit fils d’Amaterasu, sera à l’origine de la lignée des empereurs qui incarneront les seuls Kamis humains.
À la demande de l’empereur, cette mythologie a été rédigé au VIIIe siècle dans deux ouvrages appelés le Kojiki et le Nihon-shoki qui forment les Chroniques japonaises. Ces « chroniques » insistent sur l’origine divine des empereurs et justifient ainsi son pouvoir !
En 1868, le pouvoir impérial s’imposera aux Shoguns (seigneurs de guerre) et en 1871, le Shintoïsme devient alors la religion officielle de l’état japonais. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon, l’empereur Hirohito dû renoncer à se prétendre d’origine divine ainsi qu’à la plupart de ses pouvoirs politiques et le Shintoïsme perdit ainsi son statut de religion d’état.


Au Japon, Shintoïsme et Bouddhisme exercent encore aujourd’hui une influence d’égale importance, d’autant qu’ils ne s’excluent pas l’un l’autre et cohabitent souvent dans les mêmes temples. La plupart des Japonais sont à la fois shintoïstes (pour les grands événements de la vie comme la naissance, le mariage…) et bouddhistes (pour la mort et les cérémonies funéraires).
Rites Shinto essentiels comme la visite d’un sanctuaire, que nous ferons au cour des circuits, doit suivre trois étapes successives :
– la purification dans la fontaine placée devant le temple où les fidèles se lavent les mains et se rincent la bouche, purifiant ainsi leur corps à l’intérieur et à l’extérieur.
– le don d’offrandes (quelques Yens, des fruits, du Saké…)
– et la récitation de prières et/ou la sollicitation du vœu.

Les sanctuaires ne sont pas que des lieux de prières, ce sont aussi des lieux de fête shinto – appelées Matsuri 祭り- et de divertissements destinés à réjouir les Kamis.
Encore aujourd’hui le Shintoïsme est omniprésent dans la société japonaise : dans les représentations et les spectacles comme le théâtre Nô ou le Kabuki, dans les danses Nihon Buyo ou dans le Buto, dans les sports comme le Sumo ou le tir à l’arc (kyūdō). Dans les grandes entreprises, même les plus modernes où la coutume veut qu’elles offrent des Torii (portique ornemental de couleur rouge) aux sanctuaires pour que leurs affaires soient fructueuses. Dans les alcools, comme le saké qui est le « nectar des dieux shinto » consommé en plus ou moins grande quantité pendant les Matsuris. Dans tous les foyers comme dans tous les quartiers, on trouve des autels dédiés à un ou plusieurs Kamis !

Pendant votre voyage au Japon, vous les rencontrerez à maintes reprises, car ils sont incontournables !
Pierre B